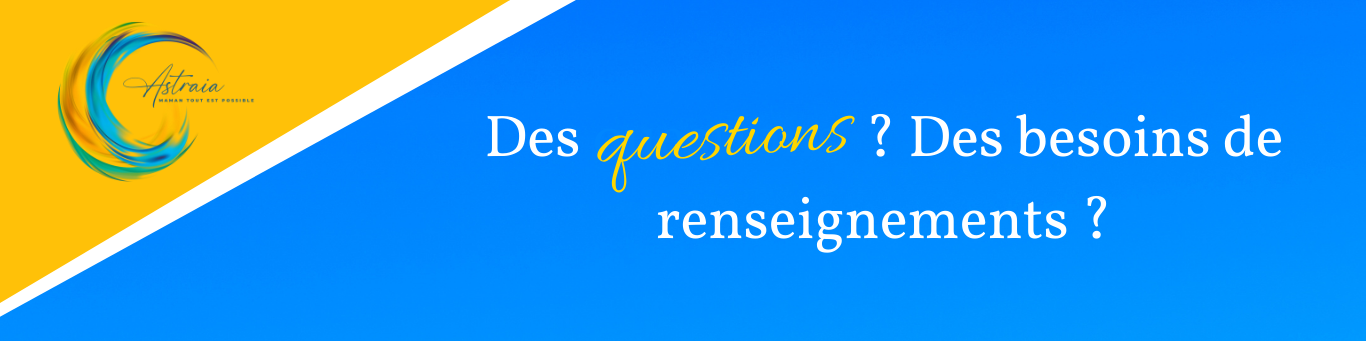Les ados face à la désinformation
🔵 J’aimerais vous parler d’un sujet qui me tient particulièrement à cœur, en tant que maman et que citoyenne : celui de la désinformation.
Ce phénomène est beaucoup et bien analysé par des journalistes et des essayistes de qualité que je vous laisse lire, plutôt que de redire leurs propos, en moins bien.
Ce qui est certain c’est que la guerre de l’information a démarré depuis un moment et nous voilà confrontés à la problématiques des fake news, des théories complotistes, de la manipulation de pays étrangers, de la propagande, du prosélytisme… qui s’imposent à nous, à notre insu.
🔵 Une question se pose donc : Comment faire avec nos ados ?
👉 Comment faire pour qu’ils s’intéressent à l’information ET qu’ils aillent sur les bonnes sources d’information ?
👉 Comment faire pour qu’ils ne croient pas tout ce qu’on leur dit MAIS qu’ils ne remettent pas non plus tout en question (ce qui ouvrirait la porte à tous les charlatans) ?
👉 Comment faire pour qu’ils ne se fassent pas happer par des idées simplistes (types populistes) et donc dangereuses car dénuées de la complexité d’une réflexion étayée et mesurée ?
Bref, comment leur donner le pouvoir de l’esprit critique, de l’esprit éclairé ?
🔵 Je n’ai malheureusement pas de recette miracle pour contrer cette désinformation qui se répand à la vitesse…des réseaux sociaux ! Mais il me semble intéressant de rappeler quelques idées de bon sens :
✨ Encouragez dès le plus jeune âge la curiosité de votre enfant. Faites en sorte que votre ado s’interroge sur le monde qui l’entoure et répondez à ses questions de manière ouverte. La curiosité n’est pas un vilain défaut, elle est le début de la philosophie…
✨ Stimulez la discussion avec des conversations respectueuses. Cela implique de ne pas être frontal dans vos objections. En effet, un adolescent est très susceptible et ne se remet pas facilement en question. En montrant à votre ado que vous l’écoutez sans le juger, il pourra se permettre à son tour d’accepter les opinions des autres… Cela va l’inciter à sortir de ce que l’on appelle aujourd’hui les « biais de confirmation ».
-
- Explication des biais de confirmation : Les réseaux sociaux, avec leurs puissants algorithmes, nous enferment dans nos croyances et renforcent sans cesse nos convictions. C’est très confortable intellectuellement puisque rien ni personne ne nous remet en question. Mais c’est justement en cela que c’est dangereux : c’est tellement plus simple de rester dans ses certitudes et de polariser les discours plutôt que d’accepter les autres points de vue et d’enrichir sa réflexion. Plus qu’un enfermement, c’est un rétrécissement de l’esprit. C’est la mort du débat.
Garder un esprit critique c’est être en mesure de sortir de cette « bulle algorithmique » pour penser « contre » soi. Plus vous ouvrez de perspective, de discussion et de sources médiatiques à votre enfant, plus il sera en capacité de sortir de ses certitudes et de « penser l’autre ».
✨ Quand l’actualité est brûlante, qu’elle suscite de l’émoi, recueillez ce que votre ado a entendu, vu, appris. Puis interrogez-le sur ses propres émotions et sur ce qu’il/elle pense de la situation. Plus vous le ferez parler de ses émotions plus il/elle en prendra conscience. Or, prendre conscience de ses émotions contribue à progresser dans la perception de celles des autres. Cela développe donc l’empathie.
✨ Ainsi en développant la discussion sans jugement, vous aidez votre enfant à développer son empathie cognitive (la capacité à comprendre le point de vue de l’autre) et en recueillant ses émotions, vous l’aidez à développer une empathie émotionnelle (comprendre les émotions de l’autre). Cette empathie globale contribue au « décentrage » intellectuel et émotionnel. Et c’est en se décentrant, que votre ado apprend à affiner sa pensée, à envisager de nouvelles réflexions, à prendre de la hauteur.
✨ Montrez à votre enfant comment vous utilisez votre esprit critique dans votre vie. Partagez vos réflexions, questionnez les informations, et expliquez vos processus de prise de décision.
N’oubliez jamais que vous êtes le modèle de votre enfant. Votre comportement l’impactera d’une manière ou d’une autre…
✨ Enfin, la lecture est sans doute le moyen le plus efficace d’ouvrir nos enfants à l’empathie, à la complexité du monde, à la structuration de l’esprit et à la raison gardée. C’est donc le moyen le plus sûr d’acquérir un véritable esprit critique…
🔵 MAIS, me direz-vous, comment les faire lire ?
👉 Cela sera le sujet d’un nouvel article…